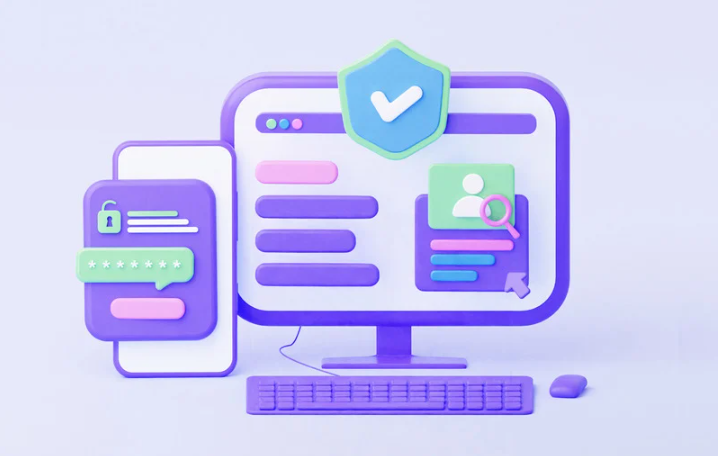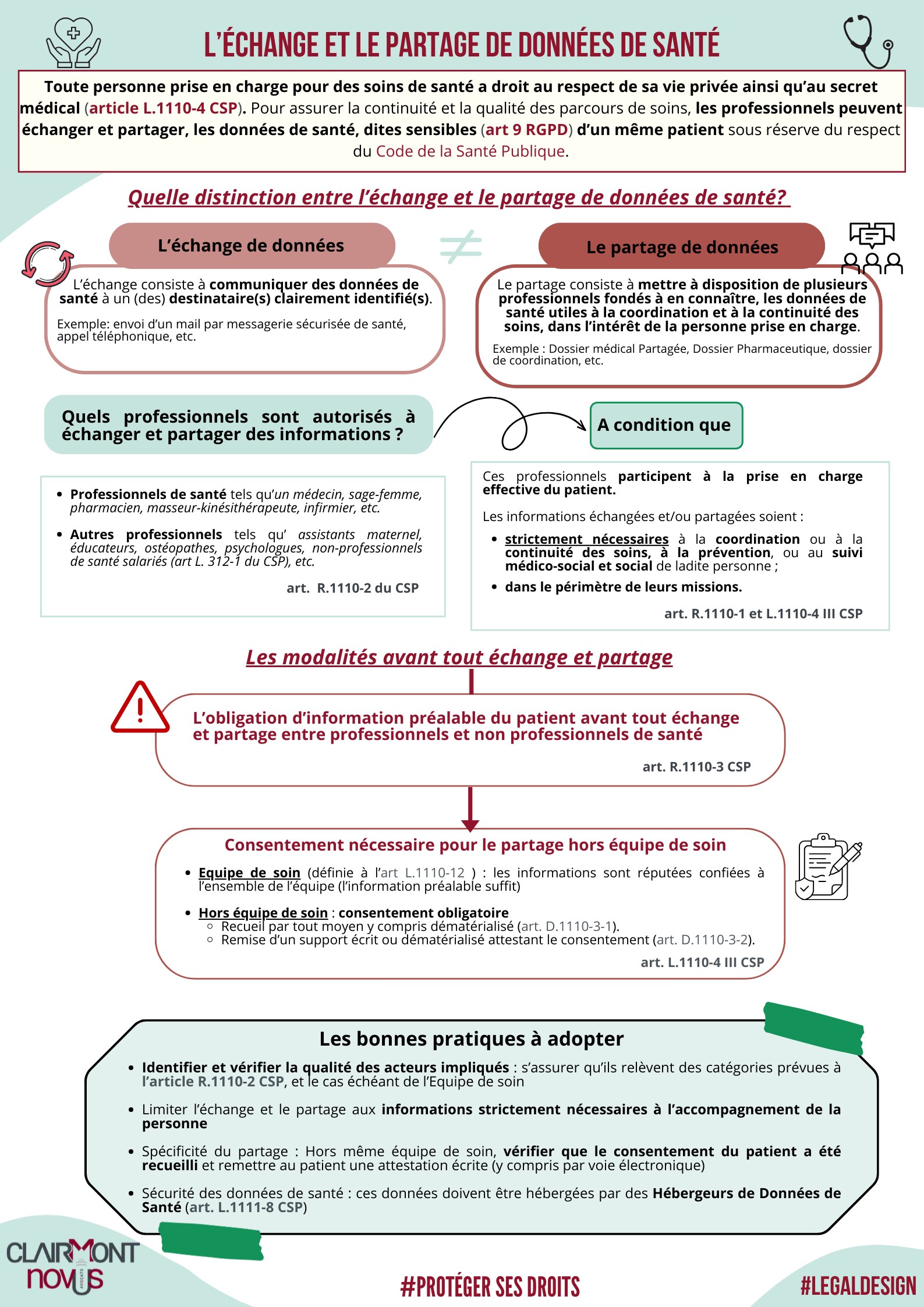Par un jugement en date du 15 mai 2025[1], la 3e chambre du Tribunal Judiciaire de Paris a sanctionné trois fournisseurs de VPN (réseaux privés virtuels en français) : Proton AG, NORDVPN et CYBERGHOST, pour avoir permis l’accès, depuis la France, à des sites de streaming et ainsi diffusé illégalement des compétitions de football professionnel.
À l’origine de cette action : la Ligue de Football Professionnel (LFP) et sa filiale LFP 1, toutes deux titulaires des droits d’exploitation audiovisuelle des championnats (Ligue 1, Ligue 2 et du Trophée des champions).
Celles-ci ont demandé aux juges :
– De reconnaître leur qualité à agir ;
– D’enjoindre aux sociétés de VPN de bloquer l’accès à plusieurs noms de domaines listés (wcfootball.net, vipleague.pm, totalsportek.ai, etc.) ;
– De leur permettre de communiquer les nouveaux sites à bloquer au fil du temps ;
– D’ordonner une exécution provisoire.
De leurs côtés, les sociétés défenderesses ont invoqué :
– L’irrecevabilité de l’action des LFP pour l’absence de qualité à agir ou à défendre ;
– La demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la CJUE (affaire AFS – usage de VPN et communication au public) ;
– La non-conformité de l’article L.333-10 du Code du sport au droit de l’Union européenne ;
– Le caractère disproportionné des mesures demandées ;
– Le coût et atteinte à leur liberté d’entreprendre ;
– Une demande reconventionnelle de dommages et intérêts (jusqu’à 4 millions USD pour Cyberghost).
Le Tribunal a fait droit à toutes les demandes de la LFP, reconnaissant l’existence d’atteintes graves et répétées à leurs droits, comme en attestaient les constats d’huissier et les précédentes décisions, notamment celle rendue par l’ARCOM le 2 août 2024[2] qui avait engagé la responsabilité des services IPTV accessibles depuis plusieurs des noms de domaine litigieux et qui diffusaient des matchs du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2.
Il a également confirmé que la LFP et sa filiale disposaient bien de la qualité à agir, du fait de leurs droits d’exploitation accordés par leur mission de service public et par une cession de droits formelle avec la FFF. Les sociétés demanderesses avaient également qualité à défendre, car elles sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes, statut visé expressément dans le Digital Service Act (DSA) et autres textes européens.
En face, les sociétés fournisseurs de VPN ont vu toutes leurs demandes rejetées. Le tribunal a ainsi débouté :
– Leur demande de sursis à statuer, car la décision de la CJUE sur l’usage des VPN concerne les droits d’auteur et non les droits sportifs protégés par l’article L.333-10 du Code du sport.
– Leur contestation de la légalité de l’article L. 333-10 du Code du sport, car cet article n’est pas une « règle technique » nécessitant une notification à la Commission Européenne, et qu’il n’est pas contraire à la directive 2000/31/CE, dite directive e-commerce.
– Leurs arguments concernant le coût des mesures, la liberté d’entreprendre, ou le caractère disproportionné des sanctions.
Il en résulte que les trois fournisseurs de VPN incriminés ont été sommés de bloquer, sous 3 jours, l’accès aux sites illégaux identifiés. Le tribunal a également autorisé la LFP à leur communiquer régulièrement une liste actualisée de sites à bloquer (les fameux « sites miroirs » qui apparaissent après le rendu d’un jugement).
Enfin le Tribunal fait application des articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport qui autorisent la LFP à communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la décision, diffusant illicitement les matchs des championnats, aux fins blocage et d’autres mesures.
Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle de plus en plus stricte à l’égard des intermédiaires techniques du web. Après l’arrêt remarqué de la Cour de cassation, le 15 janvier 2025, qui avait engagé la responsabilité de l’hébergeur DSTORAGE pour la mise en ligne de données illicites[3], ce sont désormais les intermédiaires de contournement comme les VPN qui se voient ciblés.
25 ans après l’essor des NTIC, la justice semble avoir trouvé certains outils pour encadrer un espace numérique longtemps jugé incontrôlable.
[1] Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre, 1ère section, 15 mai 2025 (n°24/15054)
[2] https://www.courdecassation.fr/en/decision/66ad23acd5af8a921ecb97ea
[3] Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2025 (n° 23-14.625)